Natureparif, l’agence pour la nature et la biodiversité en Île-de-France, édite deux études qui dressent un panorama précis de l’état de santé de la biodiversité francilienne.
Quel est l’état de santé des milieux franciliens et des espèces qui les peuplent ? Quels sont les enjeux de préservation de cette biodiversité ? Comment les politiques publiques ont-elles influé sur cette préservation ? Sommes-nous amenés à faire évoluer les stratégies de sanctuarisation des espèces et des espaces vers un modèle conciliant bon développement du vivant et activités humaines ? Autant de questions abordées par ces deux études et qui permettent de réfléchir sur les enjeux de préservation de la biodiversité au niveau régional.

Premier diagnostic de la biodiversité en Île-de-France (déc. 2013)
Véritable photographie de l’état de santé de la faune, de la flore et des écosystèmes franciliens, ce diagnostic dresse un état des lieux complet des différents milieux (humides, forestiers, ouverts, urbains) et des enjeux qui y sont associés.
Le cœur d’agglomération, qui regroupe Paris et sa petite couronne, fait l’objet d’un traitement à part. Ce territoire prend en compte de manière croissante les enjeux de protection de la biodiversité. La gestion plus écologique des espaces verts, l’arrêt de l’emploi des pesticides, l’acceptation des herbes spontanées, sont autant de facteurs qui permettent le retour des insectes ou des oiseaux.
Les pressions sur l’environnement perdurent dans les départements de la grande couronne, où l’activité agricole demeure extrêmement intensive. Avec la disparition des haies et des jachères, beaucoup d’animaux, n’y trouvant plus leur place, ont progressivement disparu du paysage. Le déclin de l’élevage a contribué à l’uniformisation des paysages. Dans ces milieux, la moitié de la faune et de la flore évaluée est disparue ou menacée, alors que cette proportion n’est “que” de 25 % si l’on tient compte de tous les milieux.
Côté zones humides, le principal problème est la maitrise presque totale des rivières. Berges rehaussées, cours rectifié, les rivières sont prisonnières de leur lit, et n’alimentent plus les prairies humides et les forêts alluviales lors des périodes de hautes eaux. Et ce au détriment des nombreuses espèces spécialistes de ces endroits, mais également des services naturels d’épuration et d’écrêtement des crues.
Les forêts demeurent le milieu le plus “naturel” d’Île-de-France, et la gestion forestière tient de plus en plus compte de la protection de la biodiversité, tout en demeurant productive. L’enjeu essentiel en forêt tient maintenant dans la réduction de la fragmentation. La forêt de Fontainebleau, joyau de la biodiversité francilienne, est segmentée par les autoroutes et les nationales, empêchant la faune de circuler. Voici un défi de taille à relever : rendre la forêt aux animaux et aux promeneurs, et en faire sortir progressivement les véhicules.
Télécharger l’étude complète

État de santé de la biodiversité 2012-2013 (janv. 2014)
Après avoir produit des éléments sur l’état général du vivant (2010), puis sur sa capacité de résilience (2011), cette étude s’intéresse à la nature et à l’efficacité des initiatives prises pour la protéger. Elle propose un décriptage poussé des premières mesures mises en place en France et en Île-de-France, comme la Loi relative à la protection de la nature de 1976 et ses effets positifs bien que tardifs sur l’évolution des populations de rapaces et de grands échassiers. Ou encore la protection des espaces, notamment par la création des Réserves naturelles, de ZNIEFFs ou d’Arrêtés préfectoraux. Des milieux à l’abandon, désormais hors de tout contexte productif, tels que les roselières ou les coteaux calcaires se voient alors conservés au prix d’importants efforts financiers. Ces mesures, toujours en vigueur et par ailleurs indispensables, dissocient souvent l’homme de son environnement et envisagent une protection radicale de portions de vivant, au sein desquelles les activités humaines sont strictement exclues. En Île-de-France, l’ensemble du territoire résulte des activités humaines et il ne subsiste pas de milieu ayant toujours évolué librement. Dans un tel contexte, les politiques doivent évoluer vers une vision plus intégrative : la vie sauvage, à savoir ni domestiquée, ni exploitée, peut être compatible avec les activités humaines si et seulement si celles-ci la considèrent comme un élément indispensable de leur stratégie et lui laissent la part qu’elle mérite. Comme c’est le cas par exemple des Zones naturelles à haute valeur naturelle (HNV), classification à même d’identifier les zones exploitées par ailleurs favorables au vivant sauvage.
Télécharger l’étude complète


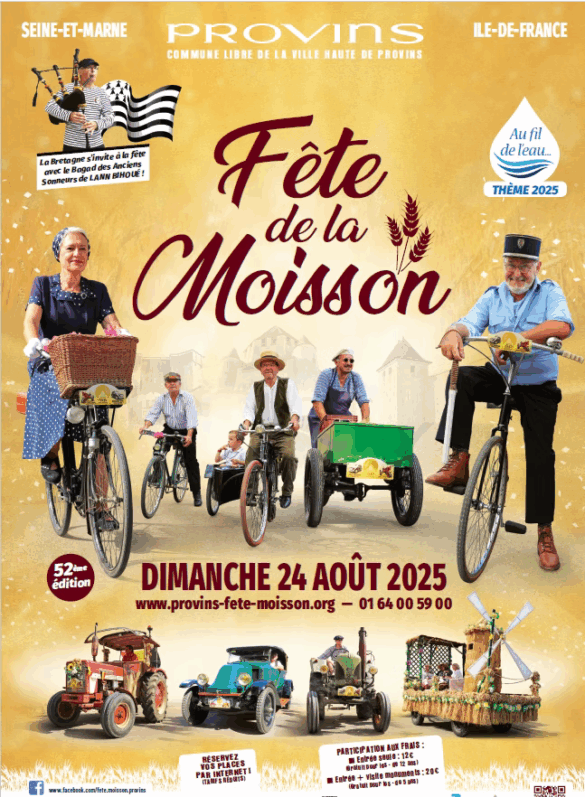


A une époque je nourrissais des verdiers sur mon balcon. Jusqu’à une cinquantaine. Toutes les fins de semaine nettoyage en règle du balcon dont je protégeais tout de même le sol.
J’avais fini par déplacer l’ère de nourrissage au coin d’un massif en limite de propriété, toujours visible depuis mes fenêtres.
Un jour lotissement en face de chez moi avec rassemblement de tous les petits jardins anciens. Plus un seul verdier et plus de bouvreuils que j’apercevais auparavant dans le plus grand terrain régulièrement entretenu.
Un jour ont disparu les geais qui venaient se nourrir régulièrement des glands d’un chêne qui a été abattu par un vieux chnoque pour cultiver quelques choux. Je vous dis pas ma rage en voyant abattre (enfantin avec un tirefond) ce chêne magnifique alors que le jardinier du dimanche avait encore largement la place pour ses cultures….
Il n’y a pas vraiment de mystère dans ce domaine, plus d’arbres, plus d’arbustes, plus d’oiseaux.
Mais où sont passés les moineaux que je nourrissais l’hiver ? ainsi que les 2 mésanges. Mon seul espoir : le nid d’hirondelles dans la gouttière au-dessus de ma fenêtre, Vont-elles revenir cette année ? C’était tellement drôle de voir les jeunes qui s’arrêtaient dans mes jardinières lors de leur premiers vols, et la tête der ma chatte derrière la fenêtre !!!
Je vais faire tout de suite un copier/coller et lire ce soir, il y a quelques temps j’habitais l’Essonne et me suis souvent promenée dans les champs près de chez moi.
J’ai vu au fil des années la nature passée au rouleau compresseur pour des raisons de constructions d’habitations, de zones commerciales et le reste anéanti par la stupidité de ceux qui possédaient les champs.
– des arbres abattus sans raison,
– nettoyage des engins agricoles dans le ruisselet, plus tard comblé,
– dépôt de bidons de produits agricoles dans ce qu’il restait des haies. Sur les restes de bidons il était pourtant marqué ” ne pas laisser cet emballage à la portée, etc ..”,
– les jachères passées au désherbant !!!
– les talus situés en dehors des routes, entourant les champs, fauchés début Juin sur ordre de la société qui gère les Eaux de la Vanne pour la ville de Paris, adieux fleurettes et orchidées, toutes passées à la moulinette.etc…
En 2003 j’avais obtenu que le fauchage soit remis à plus tard sur 2 km. Fallait voir toutes ces fleurs et tous ces insectes, la vie quoi ! Fin Juillet c’était redevenu Le Désert des Tartares…
– le département qui fait raser l’herbe des talus en bordure de route sur lesquels poussent des orchidées, même pas épargnées….Et simultanément je reçois dans ma boite un magazine gratuit du Conseil Général avec ce titre alarmiste en couverture “il faut sauver les orchidées de l’Essonne” !!!
Quant aux chasseurs ils ont fini par passer au peigne fin la nature environnante pour éliminer toutes bêtes dites, par eux, nuisibles. Plus de pies, plus de corbeaux, des pièges à bascules pour les renards en grand nombre (il devait y avoir des soldes !), bref, le désert !
Croyez moi, ça fait drôle de se promener et ne plus entendre, voir, ces oiseaux habituels pies et corbeaux.
Il y a certainement plus de vie dans le désert de Gobi que dans ce coin d’Essonne !
Je suis certaine que l’on peut construire, cultiver sans abimer à ce point l’environnement encore faut(il qu’il y ait une réelle volonté et non pas que des discours de salons..