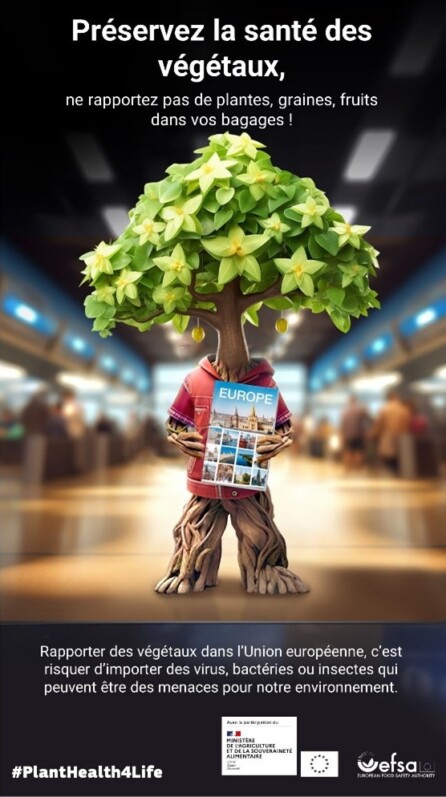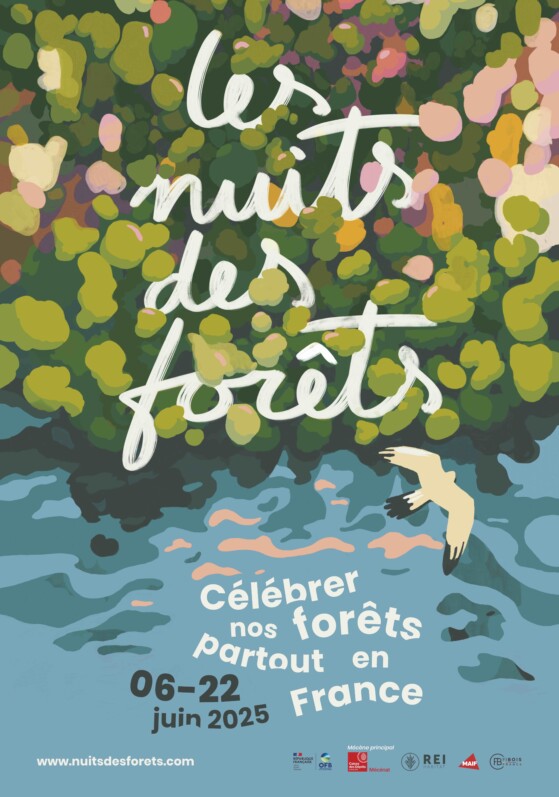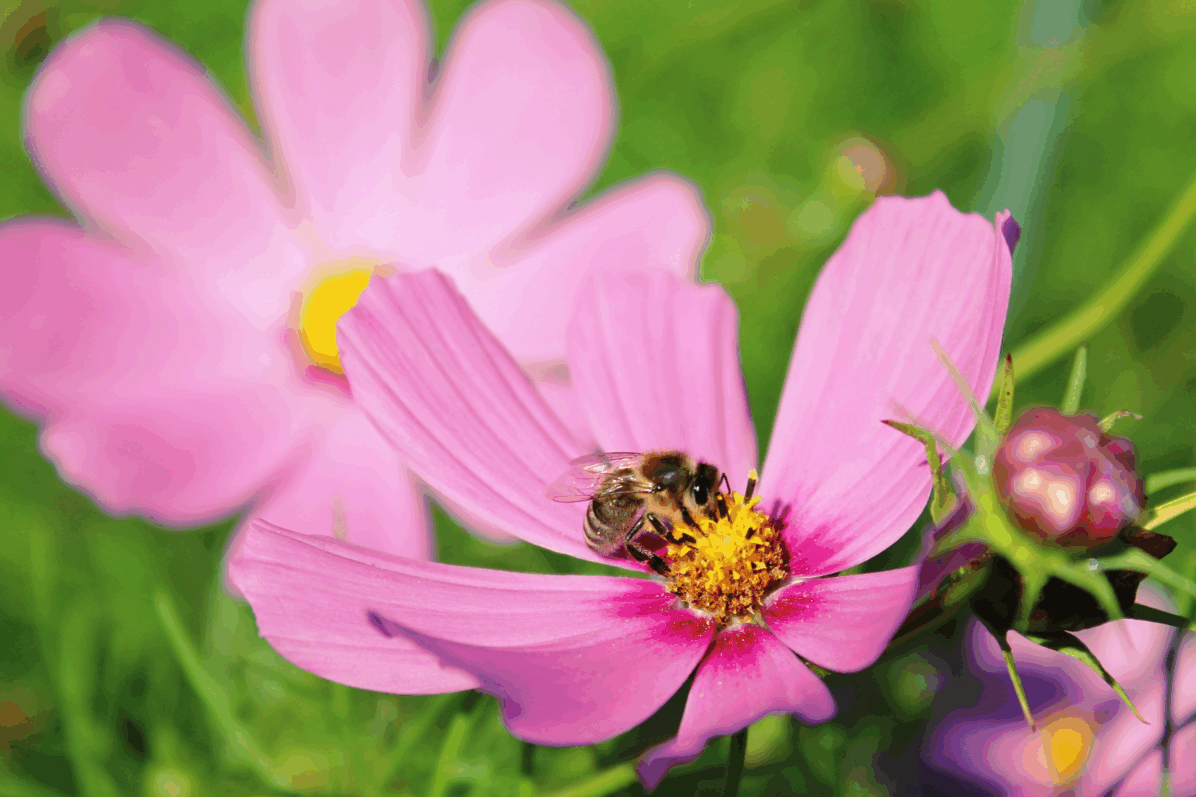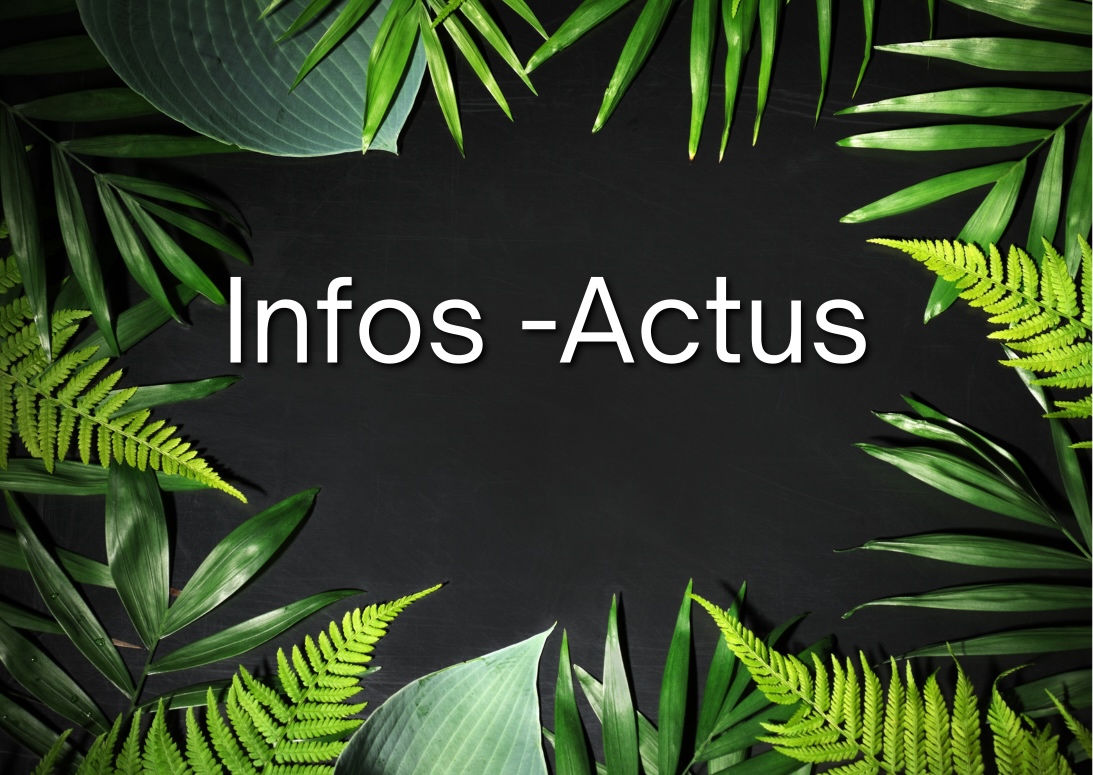
Depuis quelques décennies, le numérique se développe et a un impact important sur nos modes de vie, sur les modèles d’affaire des entreprises ou sur les modalités d’action de l’Etat. Il a été depuis longtemps perçu comme intrinsèquement vertueux d’un point de vue environnemental (“dématérialisation”, “virtuel”…). Est-ce toujours le cas ?
Certaines applications du numérique ont un impact positif sur l’environnement
Beaucoup de solutions numériques permettent d’accompagner et accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans de nombreux secteurs économiques (énergie, bâtiment, agriculture, transport, etc.) et la recherche est très active dans ce domaine souvent dénommé “IT for green”. Certaines solutions numériques, comme les plateformes de mise en relation d’usagers permettant notamment de partager des usages (covoiturage, partage d’équipements…) ou de donner une seconde vie aux produits, ont peu d’impacts environnementaux directs au regard des bénéfices environnementaux qu’elles peuvent créer.
En revanche, pour certains secteurs économiques, le numérique apporte certes un bénéfice environnemental, mais il ne doit pas se substituer à des efforts de décarbonation plus profonds. Dans l’industrie lourde par exemple, les gains d’efficacité permis par des solutions numériques existent mais sont faibles au regard d’autres leviers de décarbonation, par exemple changement de process par des technologies de rupture, changement de mix énergétique, intégration de matières recyclées ou valorisation de la chaleur fatale.
Enfin, si certaines de ces solutions ont des impacts positifs, il n’est pas certain que les bénéfices environnementaux soient toujours supérieurs aux impacts générés par les services numériques, et il reste aujourd’hui très compliqué de le mesurer. Par exemple, pour les services culturels1 (liseuse numérique…), le bilan n’est pas toujours positif. L’ADEME a lancé récemment une nouvelle étude pour établir le bilan environnemental complet d’autres cas d’usages du numérique. Les effets rebonds directs ou indirects peuvent exister et sont à prendre en compte dans le bilan environnemental global, qu’il s’agisse d’effets rebonds directs (réallocation des gains d’efficacité d’une activité dans cette même activité) ou indirects (réallocation des gains vers une autre activité).
Une bonne pratique “sans regret” consiste à favoriser le développement de communs numériques pour la transition écologique comme par exemple le Data Food Consortium qui établit un standard numérique qui se matérialise par un “catalogue de production universel” pour faciliter la vente en circuit court. Les communs favorisent les coopérations entre acteurs pour capitaliser sur une même ressource donc réduire les coûts de développement et de maintenance. Ils réduisent également la dépendance à des solutions propriétaires fermées qui occasionnent souvent un verrouillage (ou lock-in) des acheteurs.
Mais l’impact environnemental du secteur numérique est déjà significatif et en forte croissance
La prise de conscience de la matérialité sous-jacente du numérique et de ses impacts sur l’environnement est relativement récente (en France, un livre blanc en 2018 et un rapport du Shift Project en 2018).
En 2022, suite aux récents travaux de l’ADEME basés sur ceux de la SNBC, le numérique (datacenters, réseaux et terminaux) représentait en France une empreinte carbone de 29,5 Mt CO2 eq soit 4,4% de l’empreinte carbone nationale (équivalent aux émissions dues aux poids lourds) et 51,5 TWh soit 11% de la consommation électrique et, sans mesures correctrices dans les années à venir, son impact devrait croitre de manière exponentielle (études de l’ADEME et l’Arcep5). Ces impacts sont probablement sous évalués car ces évaluations ne prennent pas bien en compte la récente révolution de l’intelligence artificielle (IA) générative.
Le développement du numérique implique également une tension croissante sur les ressources, principalement minérales. Il est impossible de dire aujourd’hui si ces ressources seront suffisantes et disponibles à un coût raisonnable pour mener de front les transitions écologique et numérique. La cartographie des chaînes de valeur des métaux utilisés dans les équipements numériques montre la forte concentration des activités d’extraction dans certains pays, en particulier la Chine, qui est en situation de quasi-monopole pour 7 métaux en particulier, questionnant notre souveraineté et notre dépendance.
L’impact environnemental du numérique est majoritairement dû aux équipements (télévisions, ordinateurs, smartphones), plutôt qu’aux datacenters ou aux réseaux, même si le développement actuel de l’IA générative est en train de faire évoluer ces équilibres. Les principales mesures à mettre en œuvre sont l’allongement de la durée de vie des équipements, l’écoconception des équipements et des services numériques, la priorisation et la réduction de nos usages, l’amélioration de la performance énergétique des datacenters….
Une nécessaire réflexion sur la sobriété numérique
Même en déployant ces mesures nécessaires, l’ADEME considère que le bénéfice environnemental de certaines applications numériques ne peut justifier à lui seul de fermer les yeux sur les risques liés à leur développement rapide : l’ADEME considère ainsi qu’il faut raisonner en termes de sobriété numérique, en questionnant, priorisant et in fine réduisant certains usages numériques. C’est le cas en particulier pour les usages de l’IA générative. Nous manquons encore beaucoup de données fiables sur cette révolution récente par manque d’accès aux données des fournisseurs d’IA, mais l’Agence Internationale de l’Energie prévoit dès aujourd’hui, dans un scénario haut, un doublement de la consommation électrique mondiale liée aux data centers entre 2022 et 2026, pour atteindre les 1000TWh, soit l’équivalent de la consommation électrique du Japon.
En l’état actuel de nos connaissances, s’il est probable d’une part que cette technologie amènera des solutions nouvelles en matière environnementale (optimisation des réseaux, développement de nouveaux matériaux…) et d’autre part qu’il y aura des gains importants en matière de performance énergétique des datacenters hébergeant des services d’IA, le développement actuel des usages de l’IA générative, majoritairement centré sur des services ne visant pas la résolution de problèmes environnementaux, n’est très probablement pas soutenable. Un autre modèle d’une IA frugale est cependant possible, fondé sur le développement de petits modèles d’IA générative spécialisés plus sobres que les grands modèles généralistes. Un tel modèle présenterait un triple avantage environnemental, économique et de souveraineté et permettrait à des startups françaises et européennes d’améliorer leur compétitivité.
Quelques pistes de mesures publiques
Le numérique constitue dès maintenant un levier transversal incontournable pour mettre en œuvre la transition écologique. Il faut continuer à soutenir le développement et le déploiement de solutions ; IT for green < pertinentes et orienter prioritairement nos financements vers des solutions numériques ouvertes (communs, données open source, …).
Pour limiter les impacts environnementaux du numérique en France dans le prolongement des mesures portées depuis 2021 par la feuille de route gouvernementale 0 numérique et environnement 1, les mesures du Haut comité au numérique responsable ainsi que celles figurant dans la Loi AGEC et la Loi REEN, l’ADEME préconise de travailler sur les axes suivants :
- Augmenter la durée d’usage de nos équipements en les faisant réparer quand ils tombent en panne, en achetant davantage de produits reconditionnés, en privilégiant l’économie de la fonctionnalité ou du partage ou la mutualisation des équipements
- Généraliser les pratiques d’écoconception des services numériques : Rendre obligatoire l’atteinte d’un seuil minimal pour les services numériques basés sur le référentiel général d’écoconception de services numériques (RGESN), comme c’est le cas pour l’accessibilité avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) et pousser son adoption au niveau européen
Evaluer l’intérêt d’un indice d’écoconception sur les services numériques comme les jeux vidéo, les plateformes de streaming, les applications mobiles ou les sites internet, afin de mieux différencier une “offre verte” de services numériques - Maîtriser la croissance des usages : Impulser des changements de comportements et la mise en œuvre de politiques de sobriété numérique afin de réduire le nombre d’équipements utilisés et de limiter nos usages en interrogeant systématiquement nos besoins :
Poursuivre une campagne nationale de sensibilisation des citoyens aux impacts environnementaux et à la modération des usages et la faire évoluer et fusionner avec les messages sur les enjeux de santé publique et notamment d’exposition aux écrans chez les jeunes,
Encadrer les modèles économiques basés sur l’économie de l’attention,
Etudier la mise en place d’une tarification progressive sur les forfaits mobiles - Prioriser les financements vers des solutions numériques ouvertes (logiciel open source, données ouvertes) au service de la transition écologique tout en s’assurant d’une quantification en amont des bénéfices des solutions proposées (méthodologies solides avec une vision à moyen terme et prise en compte des effets rebonds) :
Renforcer nos politiques de souveraineté numérique, en profitant d’un mix électrique français peu carboné
Lancer des appels à projets “communs numériques” au sein des territoires et dans des filières industrielles. - Enfin, développer la connaissance des impacts environnementaux des nouvelles technologies comme l’IA générative, les univers immersifs ou le numérique quantique avant une massification de leurs usages :
Développer une base de données sectorielle dédiée au numérique intégrée à la base empreinte de l’ADEME
Poursuivre les études d’évaluation des impacts environnementaux multicritères et de référentiels par catégorie de produits
Intégrer les travaux français sur l’IA frugale dans les réflexions européennes et notamment la charte de l’IA et soutenir les petits modèles d’IA spécialisés dans une optique de compétitivité verte.
Pour en savoir plus
Site d’information grand public : www.altimpact.fr
Liste des principaux travaux publics : Ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique
- Feuille de route du CNNUM en juillet 2020 en partenariat avec le Haut Conseil pour le Climat, 20201
- Mission d’information du parlement sur l’empreinte environnementale du numérique, 2019- 20201
- Loi AGEC 2020
- Feuille de route gouvernementale sur le numérique & l’environnement, 2021
- Loi REEN 2021
Liste des principales études: Observatoire de l’impact environnemental du numérique